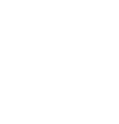LILI POPPINS CONTEUSE D’ÂME
Avec son air timide et craintif, ses cheveux toujours coiffés au fer, ses sourcils asymétriques, Armandine avait eu du mal à prendre sa place conservant parfois celle des domestiques. Lorsqu’une bonne ne convenait pas, elle ne pouvait se résoudre à la congédier. Elle savait le prix qu’il en coûte de chercher à nouveau à être placé.
Sa tante Augusta avait tenté plusieurs fois de lui trouver une bonne famille. Mais qu’est-ce qu’une bonne famille en somme ? Celle qui affiche de belles toilettes ? Celle qui se baigne dans l’opulence ? Celle qui se montre pieuse ? Rien de tout cela. A chaque fois, dans l’ombre des couloirs se déroulaient les secrets de famille. Ceux qui ne pouvaient se dire. La domestique était toujours le dommage collatéral. Armandine préférait les mal nommés, ceux qui dès leur naissance cherchaient déjà à justifier de leurs racines. Les mal nommés, les mal nés un peu comme elle. Sa mère Madeleine avait quitté ce Monde en taisant la souillure. Qui était donc son père ? Certainement le jeune châtelain où elle travaillait comme lavandière.
Armandine avait été initiée très tôt à ce métier de femmes. Entrée à 11 ans, elle se débattait souvent avec le battoir et les corbeilles dix fois trop lourdes pour elle. Ces femmes lui semblaient courageuses ; au lavoir elles remplissaient leur tâche avec ténacité pour s’assurer du manger du soir. Alternant lavages à l’eau froide, lavage à la cendre, les draps et torchons reprenaient vie après cette séance d’ablution. Oui le linge parlait aussi. Et il ne retrouvait son blanc immaculé qu’au sortir de ce travail des femmes du peuple.
La lavandière puisait sa force dans l’eau guérisseuse que ce soit un gué, un ruisseau, une fontaine, une rivière, une mare, un étang…
L’initiation par les femmes, Armandine s’en rappelait. Le groupe des lavandières était une représentation du Monde d’en bas. Comme celui de l’Assommoir et des Rougon-Macquart. Il y avait l’illuminée qui lui faisait peur, l’aînée dont la sagesse l’impressionnait, la volage qui avait toujours une histoire à raconter, la faiseuse d’ange dont elle ne comprit que bien plus tard quelle était son rôle dans ce groupe. Ici on apprenait la féminité dans la brutalité comme chaque coup porté au vêtement qui rendait l’âme. Là on apprenait à soigner les blessures de la vie et on réglait ses comptes. Parfois l’une se mettait à rire, un rire tonitruant contagieux, sa voisine avait à nouveau glissé sur le bout de savon et avait fini la jupe trempée. Et puis il y avait sa tante Augusta qui lui avait inculqué le goût de la discrétion. Armandine en avait fait un principe de vie : rester effacée pour être insaisissable.
Elle avait hérité de cette tante généreuse une robe. Noire. Elle l’avait conservé dans sa nouvelle vie ; elle n’aimait pas gâcher. Elle, habituée aux vêtements déjà portés, elle ne pouvait accepter des pièces neuves et plus modernes. Lorsque son mari faisait venir son tailleur, elle s’arrangeait pour sortir du placard une vieille robe à réhabiliter.
Elle ne portait que du noir. Toujours. Son signe distinctif. Sa seule fantaisie : des brillants sombres. Elle les avait troqués en cachette à la couturière du château. Elle tenait absolument à ce que tout ce qu’elle porte, puisse rayonner la vie d’avant. Une vie remplie ou bien une vie vide. Elle gardait à son cou un collier 1900 offert pour ses fiançailles. Un collier en or jaune dix-huit carats à la draperie édouardienne antique. Discrétion dans les salons du château. Juste équité pour réparer la faute. Le châtelain avait tenu ses engagements et avait lavé l’honneur de la famille. Du battoir au sautoir. Le destin d’une vie. Madeleine, Armandine et tant d’autres encore.
Elisabeth Freund